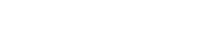La conduite en état d’ivresse est une des principales causes d’accident mortel en France. Selon les statistiques de la Sécurité routière, l’alcool est responsable de 30% de la mortalité routière.
Même après avoir consommé une petite quantité d’alcool, prendre le volant met en danger la vie du conducteur, celle de ses passagers et des autres usagers de la route. Ce comportement dangereux est à l’origine de nombreuses interpellations par les forces de l’ordre. Un test d’alcoolémie est une procédure utilisée dans une très grande majorité des contrôles routiers ou en cas d’accident de la route.
Nous vous expliquons ici les modalités de contrôle, les risques encourus et les recours éventuels à votre disposition.
La procédure de test de l'alcoolémie : quand et comment ?
Le test d'alcoolémie aléatoire
Lors d’opérations de contrôle routier sur les routes ou autoroutes, les agents des Forces de l’ordre peuvent procéder à des vérifications. Le test d’alcoolémie est une des vérifications effectuées. Les contrôles vont être réalisés sur des véhicules de façon aléatoire. Un automobiliste qui ne semble pas avoir consommé d’alcool sera donc testé dans le cadre de ce contrôle routier.
Pour pouvoir établir l’infraction, les gendarmes ou policiers doivent procéder à un dépistage qui permettra de déterminer le taux d’alcool dans le sang.
Le test d'alcoolémie en cas de suspicion de conduite en état d'ivresse
Les forces de l’ordre peuvent également procéder à un contrôle du taux d’alcoolémie à n’importe quel moment, face à un automobiliste qui pourrait se comporter de façon étrange sur la route. L’agent de police ou le gendarme pourra lui demander de procéder à un test pour confirmer ou infirmer l’état d’ivresse.
Dans certains cas, l’observation effectuée par l’agent assermenté suffit à déterminer un état d’ivresse manifeste : des signes de comportements, comme des paroles incohérentes, des problèmes de coordination de mouvement, une agressivité exacerbée, une forte odeur d’alcool et des yeux rouges … peuvent suffire à établir l’infraction.
Les méthodes de contrôle de l'alcoolémie
Le taux d’alcoolémie équivaut à la quantité d’alcool pur contenu dans le sang. Il est exprimé en grammes par litre ou en milligrammes par litre d’air.
Le contrôle du taux d’alcool dans le sang sera réalisé, en première intention, grâce à un éthylotest : l’automobiliste doit souffler dans un embout à usage unique. L’éthylotest peut être chimique (un réactif fait changer la couleur si positif) ou électronique (des capteurs électrochimiques vont fournir une réponse sur un écran digital). Si l’éthylotest est positif, il va falloir procéder à une vérification précise.
Un éthylomètre sera utilisé sur place par les forces de l’ordre. Cet appareil va donner une information précise sur le taux d’alcool dans le sang.
La mesure de vérification peut également être effectuée grâce à une prise de sang. Cependant, cet examen doit être effectué par un médecin ou une personne autorisée à effectuer ce type d’examen. Les forces de l’ordre devront donc accompagner l’automobiliste à l’hôpital. Plus difficile à mettre en place, cet examen vous sera rarement proposé. Mais si l’automobiliste le demande, il ne peut lui être refusé.
À noter : en théorie, il est possible de refuser de se soumettre à un test par éthylotest. Cependant les Forces de l’ordre vont vous demander de vous soumettre à l’éthylomètre ou la prise de sang. Si l’automobiliste refuse cette étape de vérification, il s’expose aux mêmes sanctions qu’un conducteur mesuré à plus de 0,8g/l (délit routier).
Les conséquences en fonction du taux d'alcoolémie
Conduire en dépassant le seuil légal d’alcoolémie expose le contrevenant à de graves sanctions pouvant aller jusqu’à une peine de prison.
Conducteurs confirmés
Entre 0,5 g/l et 0,8 g/l (soit entre 0,25 mg/l et 0,4 mg/l) :
Retrait de 6 points sur le permis
Contravention de classe 4 d’un montant forfaitaire de 135 €
Jusqu’à 750 € d’amende
3 ans maximum de suspension de permis
> 0,8 g/l (> 0,40 mg/l) :
Délit
Retrait de 6 points sur le permis
Amende de 4 500 € maximum
Suspension ou annulation du permis de conduire et confiscation du véhicule
2 ans de prison maximum
Au moment de la reprise de la conduite, obligation d’équiper le véhicule d’un dispositif homologué EAD (éthylotest anti-démarrage) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière
À noter : les sanctions sont identiques pour les conducteurs ayant refusé de se soumettre au contrôle de dépistage
Jeunes conducteurs en permis probatoire
Entre 0,2 g/l et 0,8 g/l (soit entre 0,10 mg/l et 0,4 mg/l) :
Retrait de 6 points sur le permis
Contravention de classe 4 d’un montant forfaitaire de 135 €
Jusqu’à 750 € d’amende
3 ans maximum de suspension de permis
Au moment de la reprise de la conduite, obligation d’équiper le véhicule d’un dispositif homologué EAD (éthylotest anti-démarrage) pendant 3 ans maximum
> 0,8 g/l (> 0,40 mg/l) :
Délit
Retrait de 6 points sur le permis
Amende de 4 500 € maximum
Suspension ou annulation du permis de conduire et confiscation du véhicule
2 ans de prison maximum
Au moment de la reprise de la conduite, obligation d’équiper le véhicule d’un dispositif homologué EAD (éthylotest anti-démarrage) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Certaines circonstances aggravantes vont également avoir un impact sur les sanctions encourues : la présence de mineurs dans le véhicule, le cumul avec d’autres infractions (comme le non-respect du port de la ceinture de sécurité), l’association alcool et drogue, une conduite en état d’ivresse ayant entraîné un accident grave…
Une récidive dans un délai de 5 ans sera classée en délit. Le permis de conduire sera automatiquement annulé pour une durée de 3 ans maximum et la peine de prison pourra être de 4 ans. Auxquelles viendra s’ajouter toute une série de sanctions impactant le quotidien et l’autonomie de l’automobiliste.
Les recours et les stages de sensibilisation à la sécurité routière
Si vous estimez que vous ne conduisiez pas en état d’ivresse malgré un premier test positif, vous pouvez demander une contre-analyse, idéalement une prise de sang, dont les résultats serviront d’argument durant votre recours. Vous aurez ensuite 45 jours pour contester l’infraction, par courrier AR auprès de l’Officier du ministère public du département de l’infraction. Vous pouvez également faire appel à un avocat spécialisé pour vous aider à contester l’infraction.
Parmi les différentes sanctions qui seront appliquées suite à l’infraction, le contrevenant devra effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière : un temps de formation qui lui permettra de faire le point sur son comportement à risque et de trouver les ressources pour adopter une conduite plus sûre pour lui et les autres usagers de la route. Attention, ce stage ne lui permettra pas de récupérer de points sur le permis.